Jean Morlong, président d’honneur de la section de Maine-et-Loire de l’AMOPA, présente dans cet article les combats et les luttes sociales qui ont accompagné l’exploitation du schiste. Il fait suite à plusieurs articles parus dans la rubrique « Patrimoines en Maine-et-Loire » consacrés à ces pages d’histoire et des techniques qui ont marqué la région d’Angers. Jean Morlong s’attache dans cette première partie de son étude à la période 1741 – 1856.
Les premières contestations et révoltes.

Après avoir obtenu la suppression du droit de forestage en 1740, les exploitants formulent une nouvelle demande pour mettre fin au privilège que les fendeurs s’étaient attribués : réserver l’apprentissage du métier à leurs propres enfants. En 1741, un nouvel arrêté royal est publié où est fait interdiction, sous peine de punition exemplaire, de troubler ou d’inquiéter les exploitants ou les ouvriers tenus de former des apprentis. Les fendeurs ne tiennent pas compte de cet arrêt. Des affiches sont déchirées dans des carrières ayant embauché des apprentis. Ils sont chassés et menacés, leurs outils sont brisés. Les plus coupables des mutins furent emprisonnés et condamnés à des peines pécuniaires, certains d’entre eux mis en prison. Ils payèrent très chèrement leur geste de révolte et d’indépendance.
En 1749, un nouvel arrêt est édité qui se heurte toujours à l’hostilité des fendeurs et reste lettre morte.
En 1765 : Publication d’un mémoire titré « Instruction pour traiter et exploiter les carrières à meilleur marché et utilement ».
Le mémoire a pour auteur Louis Sarthe, échevin de la ville d’Angers, actionnaire et exploitant de la carrière du Pigeon ouverte faubourg Saint-Michel à Angers et de celle Villechien à Saint-Barthélémy d’Anjou. Sont critiquées avec véhémence les pratiques des exploitants, sont dénoncés leurs désaccords sur le prix de vente des ardoises, la forme vicieuse des contrats de société, le mépris des ouvriers vis-à-vis de leur autorité, leur esprit de révolte qui n’a pour objet que la dissipation et l’indépendance.
Quand arrive la Révolution, par leur pugnacité, les ouvriers en particulier les fendeurs ont pu défendre leurs privilèges, les imposer à des entrepreneurs divisés.
Les révoltes de Perreyeux les 4, 5 et 6 septembre 1790.
En 1790, les denrées, surtout le pain, ont augmenté dans des proportions importantes. La misère engendrée par le chômage et la spéculation sur le blé soulèvent des troubles sur les marchés. Le 4 septembre 1790, jour de marché à Angers, deux cents femmes renversent et incendient les étals des marchands. Le Maire d’Angers, Louis-Charles-Auguste de Houlières, fait intervenir le régiment Royal Picardie, en garnison à Angers, qui met de l’ordre et fait prisonnier un meneur condamné à être pendu ; la foule le libère. Le surlendemain, une meute de Perreyeux, armés de fusils, de brocs, de bâtons, de piques, des ouvriers des manufactures et du port, les rejoignent sur le Champ de Mars. Le Maire vient à leur rencontre et leur annonce une baisse de prix du pain brun. On croit l’émeute terminée mais des coups de feu sont tirés contre la Garde Nationale ; la loi martiale est proclamée. Le régiment Royal Picardie est appelé en renfort et use de ses armes contre les manifestants. Douze morts disent les uns, une soixantaine pour d’autres. Quatre meneurs dont deux ardoisiers et une femme sont pendus. Il est certain que ces événements sont restés vivaces chez les ardoisiers et qu’on en trouvera la résonance lors des mouvements qui jalonneront le XIXe siècle.
Plusieurs carrières durant la Révolution ont été achetées comme biens nationaux.
La montée des tensions.
La Révolution française suivie des guerres de l’Empire a eu un effet néfaste pour l’industrie ardoisière qui est en crise au début du 19ème siècle. Avec le blocus de l‘Angleterre, il y a plus de huit mois de stock dans les carrières qui se trouvent financièrement déficitaires. Les ouvriers sont les victimes de ces difficultés économiques. De 3000 ouvriers en 1789, on passe à 1800 en 1806…
En septembre 1807, les fendeurs se groupent en association « Le Conseil de l’ouvrier » et revendiquent une augmentation de salaire. Elle est accordée sur quelques carrières mais jugée insuffisante. Il y a ceux qui n’ont rien obtenu et presque de force, ils s’imposent dans les chantiers où les salaires sont plus avantageux. Ils sont repoussés, se livrent à des voies de faits et entraînent leurs camarades à quitter l’ouvrage. Après avoir suspendu tous les travaux, pour protéger leurs établissements, les patrons en appellent au Préfet afin qu’il use de son autorité pour rétablir l’ordre et imposer les arrêtés antérieurs à la Révolution.
Le Préfet fait désigner par le tribunal de commerce deux rapporteurs, Pierre-Michel Testud négociant et Jean Dupont propriétaire, ayant pour mission de réaliser un rapport sur le personnel des ardoisières. A noter que cette commission n’est pas établie sur une base paritaire ; elle ne comporte aucun ouvrier.
Extrait du rapport : « Les fendeurs forment une aristocratie plébéienne avec des règlements sévèrement observés pour l’admission en apprentissage des chérubins, fils des maîtres fendeurs, les sommes versées au moment d’une naissance d’un enfant mâle, prolongée à 6, 9 et 13 ans, la distribution des hottées supplémentaires est considérée abusive.«
Pour les fonceurs est exigée une participation financière pour entrer dans la profession qui est suivie durant toute l’initiation de l’apprenti. Tout cet argent est dépensé en beuveries qui font perdre du temps et qui sont une cause de désordre, au grand dommage des exploitants. Dès qu’il était reconnu assez habile pour être admis dans une compagnie comme fonceur, il est adoubé au cours d’une curieuse cérémonie comportant des règles fixes, appelée le « Guêtrage ». Cette cérémonie est festive et bien arrosée. Souvent elle se prolonge durant plusieurs jours. Cette tradition provoque des désordres dont souffrent les fendeurs par manque de pierre. En conclusion, les commissaires déclarent que ces débauches sont préjudiciables aux ouvriers et à leur famille, ainsi qu’aux entrepreneurs, que les salaires accordés aux carriers sont plus que suffisants et supérieurs aux autres professions exercées dans tout le département. Ce rapport fait aussi état de la constitution par les fendeurs, d’un « Conseil ouvrier » en contradiction avec la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Conclusion, la demande d’augmentation est refusée.
A partir de 1817, la situation s’améliore. Se sentant plus forts, les exploitants modifient la distribution de la pierre.
L’instabilité des fendeurs, et sur décision du Préfet, obligation leur est faite de détenir un certificat de travail exigible pour l’admission dans une autre carrière. Les fendeurs contestent cette réglementation, ils se jugent libres de changer de carrière comme bon leur semble… « Nous ne sommes pas des gens à gage, nous sommes propriétaires de nos outils et de la pierre qui nous est attribuée… »
Des rapports sont adressés au Préfet précisant qu’il se produit toujours des actes de violence, parfois sanglants lors de l’embauche d’apprentis.
Pour casser définitivement cette indiscipline, le patronat utilise une affiche copiant les affiches de police prévoyant de faire une retenue de un franc par mile d’ardoises fabriquées sur la paye des fendeurs ayant prononcé des paroles séditieuses ou coupables de brutalité. En 1819, la situation n’a pas évolué, les fendeurs luttent toujours pour le maintien de leurs anciens droits. En juin une grève est déclenchée, vite suspendue par une menace de lock-out.
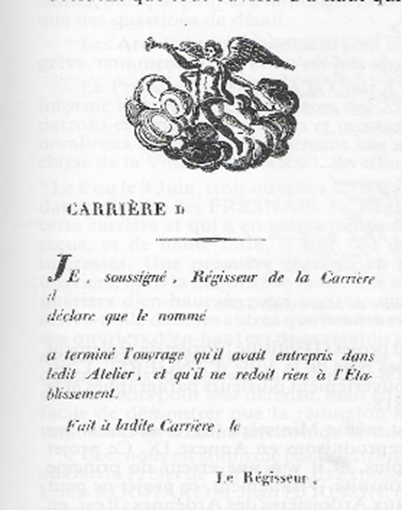

Cartels patronaux.
En 1808, l’Administration préfectorale avait présenté un projet d’organisation commerciale de vente commune des ardoises plus ou moins anarchique. Sartre en 1765, avait déjà dénoncé ce défaut d’organisation commerciale, ce projet est alors resté en attente.
Le 10 janvier 1820, le Préfet propose la création d’un groupement de vente en masse des ardoises fabriquées. En février 1820, trois carrières se regroupent et signent un accord de vente de leurs produits de production signataires : René Montrieux père (1790-1852), Montrieux fils (1804-1882), Carré, Guichard, Bazille…
En 1827, d’autres propriétaires, actionnaires et intéressés les rejoignent ; il se crée un cartel de vente « La Commission des Ardoisières » appelé à soustraire les producteurs à l’arbitraire des négociants et acheteurs. La concentration de l’industrie ardoisière sera en partie définitive en 1891, sous le nom : « Commission des Ardoisières d’Angers C. Larrivière et Cie », sauf pour quelques carrières qui se regrouperont en 1894 sous le nom de : « Société des Ardoisières de l’Anjou ».
La fin des privilèges.
Après bien des démarches auprès du Conseil Général des Mines et du Ministère de l’Intérieur, une Ordonnance Royale est signée en octobre 1823, suivie d’un règlement intérieur publié le 10 mai 1825, sanctionnant pratiquement les droits de fait, mettant un terme au nomadisme des fendeurs et leur emprise sur l’apprentissage, supprimant l’attribution des hottées supplémentaires accordées au fur et à mesure de l’avancement de l’âge du chérubin, met fin au contrôle de l’embauche de nouveaux ouvriers qui sont désormais recrutés par les entrepreneurs.
Il est aussi mis fin aux traditions instaurées par les fonceurs : participation financière durant l’apprentissage du métier et suppression de la cérémonie du guêtrage. La rupture de ces traditions malthusiennes assure une plus grande stabilité de la main d’œuvre spécialisée, fendeurs et fonceurs. Ces règlements garantissent une production d’ardoises plus régulière et notablement accrue. La productivité par fendeur de 1808 à 1848 a doublé ; les méthodes de fabrication de l’ardoise n’ont pas changé et l’outillage est toujours resté rudimentaire. Pour les ouvriers « d’à-bas », la productivité a aussi doublé grâce aux machines à vapeur qui ont remplacé la force animale et grâce une meilleure organisation du travail.
Ainsi s’achève cette première phase des luttes ardoisières. Constatons qu’elles se soldent, pour les Perreyeux, par un échec qui était prévisible. Les traditions étaient un obstacle réel à l’expansion de l’industrie ardoisière.
Parallèlement à son expansion commerciale, l’industrie ardoisière poursuit et accentue la modernisation des exploitations avec une étonnante régularité au milieu du 19ème siècle. Pendant plusieurs décennies, un patronat de combat va régner sur un prolétariat résigné, passif, inorganisé. Ce prolétariat va permettre la constitution d’un empire économique et de très belles fortunes. L’accroissement massif de la production n’a en rien modifié les conditions de vie des ouvriers carriers. Leur niveau de vie est resté à peu près inchangé et demeuré insuffisant et précaire avec un salaire qui permet de subsister tant bien que mal, et plutôt mal que bien. Entre une productivité en progrès continu, se traduisant par des profits financiers constants dont ne profitent pas les salariés qui restent toujours à la traîne avec des salaires qui ne suivent pas l’augmentation des produits alimentaires, une classe privilégiée profite du travail d’un prolétariat qui éprouve d’énormes difficultés pour vivre décemment.
Les débuts des protections sociales.
Au début du 19ème siècle, il n’y avait aucune protection sociale et les accidentés du travail n’avaient droit à rien, pas plus que les veuves et les enfants des accidentés décédés. Ils vivaient de charité. Le 11 septembre 1822, une veuve a perçu lors du décès de son mari sept pains de douze livres et vingt francs. De même en 1825, une veuve se voyait attribuée un pain de douze livres par semaine pendant un an. En 1825, après l’accord de l’autorité préfectorale, est créée une caisse de secours appelée « Caisse des centimes » destinée à indemniser les ouvriers blessés, les veuves et leurs enfants orphelins. Les ouvriers qui constituent les fonds de cette caisse n’y exercent aucun contrôle. Elle est gérée par les commissaires des carrières et alimentée par une retenue sur le salaire de un centime par franc gagné.
Après dix mois de fonctionnement, le fonds de caisse est de 10363 francs et 7138 francs d’indemnités ont été distribués.
Les indemnités journalières versées aux accidentés entre 1825 et 1850 :
- Les ouvriers d’à bas : 0, 75 F Les journaliers : 0 ;60 F
- Les ouvriers d’à haut : 0,75 F Rouliers : 0,25 F
- Les bassicotiers : 0,75 F De 12 à 14 ans : 0,40 F
Au-delà de quatre-vingt-dix jours d’arrêt de travail, les secours sont ramenés à 0, 50 F par jour. Est attribuée :
- Aux veuves : 100 francs de rente annuelle,
- Aux orphelins jusqu’à l’âge de 10 ans : 50 francs,
- Aux orphelins de 10 ans à 15 ans : 30 francs.
Mais l’aide allouée est très vite jugée insuffisante par les ouvriers. La prédominance du patronat dans la gestion des fonds soulève bien des réticences et est loin d’être approuvée par l’ensemble des cotisants.
La Caisse des hottées.
Depuis le milieu du 18ème siècle les fendeurs avaient créé une caisse de secours dite « Caisse des hottées » destinée à apporter une aide financière aux fendeurs devenus vieux et aux camarades blessés ou malades déclarés inaptes au travail par le médecin de la Commission des ardoisières. L’ouvrier reconnu dans cette situation, et selon les années passées sur les perrières, peut bénéficier de l’affermage d’un nombre de hottées (quatre ou six). Les régisseurs se chargent de répartir les hottées aux fendeurs. Le nombre d’ardoises fabriquées est compris dans le salaire. Le fermage des hottées reste à sa charge et cet argent revient au bénéficiaire. Le prix de la hottée en 1825 était de 13 F par semestre, ce qui faisait une rente annuelle de 104 F pour quatre hottées et 156 F pour six hottées.
Crise économique et sociale durant les années 1846, 1847, 1848.
Une crise de subsistances sévit à la suite de deux mauvaises récoltes de céréales et à celle de la maladie des pommes de terre, provoquant une augmentation des denrées alimentaires. En 1848, s’ensuit une crise financière. L’industrie ardoisière, comme les autres industries en France, a subi cette crise avec une mévente des ardoises provoquant une augmentation importante des stocks. Soixante-dix millions d’ardoises sont stockées, ce qui représente la moitié de la fabrication d’une année. Début 1848, une réduction d’effectifs frappe plus de 1000 ouvriers qui perdent leur emploi. (Certains ouvriers licenciés retrouvent un emploi dans la construction du chemin de fer très actif à cette époque). Les effectifs passent de 2476 à environ 1400 personnes. Il faudra attendre 1852 pour retrouver au moins 2000 personnels. Aux licenciements s’ajoutent des périodes de chômage et des baisses de salaire : 0,50 F le 1er juillet 1848, 0,50 F le 1er août 1848.
Proclamation de la Deuxième République.

Les 22, 23 et 24 février 1848, sous l’impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple de Paris se soulève et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Le 24 février, le roi Louis Philippe abdique. Le même jour, un Gouvernement provisoire est installé et proclame la république. Il comporte onze membres d’opinions politiques différentes ralliées à la République. Durant les mois qui suivent, le suffrage censitaire est remplacé par le suffrage universel réservé aux hommes de plus de vingt et un ans. L’esclavage dans les colonies et la peine de mort en matière politique sont abolis. Le droit de réunion est rétabli. La journée de travail est fixée à dix heures à Paris et onze heures dans le reste du pays. Le droit au travail est rétabli. Sont créés des ateliers nationaux pour procurer du travail aux chômeurs.
Les mesures sociales annoncées par le Gouvernement provisoire se mettent en place. Elles étaient portées, à cette époque, par les socialistes : Armand Barbès, Louis Blanc, Auguste Blanqui, François-Vincent Raspail et autres républicains démocrates sociaux. Une poignée de fendeurs regroupés autour de Rohard et Gaignard constituent le 1er juin 1848 un syndicat « De défense des intérêts généraux ». Le 1er aout 1948 est entamée une grève générale pour protester contre les baisses des salaires. Le patronat refuse toute augmentation de salaire. Il prend seulement l’engagement que les diminutions salariales n’iront pas au-delà de 15%. L’appauvrissement et la misère ne font que s’accentuer dans les ménages.
Assemblée Nationale constituante.
Selon la tradition républicaine de 1789 à 1792, le gouvernement provisoire décide la rédaction d’une nouvelle constitution par une Assemblée nationale constituante, élue au suffrage universel masculin. Des élections se déroulent les 23 et 24 avril 1848, avec 84% de votants dans une France encore rurale qui massivement vote pour les notables locaux. Les libéraux obtiennent la majorité absolue et ils reviennent rapidement sur les avantages sociaux accordés par le Gouvernement provisoire. La suppression des Ateliers nationaux provoque une insurrection qui est réprimée dans le sang par le général Cavaignac, avec un bilan répressif particulièrement lourd : 1500 fusillés, 15000 prisonniers, jugés par des conseils de guerre, 500 sont déportés en Algérie. Préparée par une commission de dix-huit membres, la constitution est adoptée le 4 novembre 1848. Elle fixe l’élection du Président de la République en décembre 1848, au suffrage universel masculin pour un mandat de quatre ans ; il n’est pas rééligible. Le Président dispose du pouvoir exécutif pour former un gouvernement. L’assemblée est élue pour trois ans et dispose du pouvoir législatif.
Élection du Président de la République.
Élu à l’Assemblée Constituante le 25 septembre le 10 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte est élu Président de la République avec 75,3 % des suffrages exprimés, Cavaignac (Républicain modéré) obtient 19,73% et Ledru-Rollin (Républicain socialisant) 5,07%. A Trélazé ont obtenu : Louis-Napoléon Bonaparte 93,41% des suffrages exprimés, Cavaignac 44 voix, Ledru-Rollin 2 voix. Bonaparte, ainsi qu’il le dit lui-même, son programme c’est : « L’ordre, l’autorité, la religion, la propriété, le bien-être du peuple ». Idées fondamentalement bonapartistes. L’Assemblée nationale constituante se dissout le 26 mai 1849 après avoir fixé les élections pour une assemblée législative les 13 et14 mai 1849.
Assemblée nationale législative (28 mai 1849 – 2 décembre 1851).
Aux élections législatives des 13 et 14 mai 1849, un « Parti de l’ordre » dominé par les conservateurs obtient la majorité absolue avec 450 députés. L’opposition se retrouve réduite avec 180 députés : 105 démocrates sociaux et socialistes composant le groupe (La Montagne) et 75 républicains modérés. « La Montagne », est une opposition de gauche qui, au travers d’une vision parlementariste, veut vaincre l’ignorance et la misère. Le Président constitue un gouvernement conservateur anti-républicain composé des deux familles monarchistes, légitimistes et orléanistes et de bonapartistes. L’opposition gêne « le Parti de l’ordre » qui attend la première occasion pour le décapiter. 11 juin 1849, Ledru-Rollin intervient et demande à l’Assemblée de mettre en accusation le Président de la République et le Gouvernement qui se sont mis hors la loi en envoyant à Rome un Corps expéditionnaire français sous les ordres du Général Oudinot pour rétablir dans la ville éternelle le Pape Pie IX qui s’était exilé, suite à la proclamation d’une République par Mazzini à Rome. Cette intervention est contraire à l’article 5 de la Constitution de 1848 qui stipule : « Que la République française n’emploie jamais la force contre la liberté d’aucun peuple. Cette demande est rejetée par 361 voix contre 202. Le 13 juin 1849, les démocrates-sociaux organisent une manifestation qui se veut pacifique pour protester contre ce refus. Ce rassemblement fut vite dispersé par la troupe mais certains manifestants tentent de résister. Dix députés du groupe « La Montagne » sont arrêtés, d’autres réussissent à s‘échapper dont Ledru-Rollin. trente-six sont expulsés de l’Assemblée Nationale. L’opposition est complétement décapitée, des députés en prison ou en fuite, Ledru-Rollin exilé à Londres. Un arsenal de lois répressives et anti-sociales est promulgué par le Gouvernement.
Malgré les réserves du Président de la République, le 31 mai 1850, l’assemblée vote une réforme du code électoral qui exclut du scrutin les électeurs qui ne résident pas dans les communes depuis au moins trois ans. Les ouvriers qui changent souvent de travail et de résidences perdent ainsi le droit de vote. Trois millions d’électeurs sont éloignés des urnes. A Paris, 1/3 du corps électoral est réduit au silence ; la proportion dans les villes du Nord est de 50%, de 40% à Rouen et à Lyon. Les cantons ruraux par contre gardent le plein de leurs électeurs.
Ayant purgé le corps électoral, la réaction s’attaque à la presse socialiste jugée responsable des votes favorables à la gauche aux élections. Il la réduit au silence avec une loi votée augmentant le cautionnement et les frais de publication. Il faut être riche pour publier un journal et aussi pour le lire. L’autorisation du Préfet est nécessaire pour afficher dans les rues. Une législation frappe les clubs et sociétés avec l’obligation de se dissoudre.
La gauche réduite à la clandestinité n’est pas pour autant brisée. Elle mène son combat pour un régime politique plus social et égalitaire, respectueux de la souveraineté nationale, au sein de « Sociétés secrètes républicaines ». Ainsi en quelques mois seulement, la Deuxième République a déçu ceux qui avaient fondé de lourds espoirs en elle, le rêve d’une République sociale a disparu. Le syndicat créé le 1er juin 1848 aux ardoisières à Trélazé a été dissous. En mars 1850, la loi Falloux relative à l’instruction publique au nom de la liberté de l’enseignement, renforce l’influence de l’Église catholique dans l’enseignement primaire et secondaire. Elle obtient un droit de contrôle des instituteurs, l’organisation et le contenu des programmes de l’enseignement public. Pour satisfaire les catholiques est rétabli le culte au Panthéon.
Une question hante le monde politique, en mai 1852, les mandats de l’Assemblée et du Président prennent fin. La situation est surtout critique pour Bonaparte car la constitution de 1848 ne lui permet pas d’être réélu. Le 31 mai 1851, une proposition de révision de la Constitution est déposée. Après un débat où s’opposent partisans et adversaires à cette révision, celle-ci est rejetée par 446 voix contre 270 pour. Le Président entre en conflit avec le Parlement. Pour se donner une posture démocratique, il demande l’abrogation de la loi électorale du 31 mai 1850, par 355 voix contre 348. L’Assemblée refuse, elle vient de signer sa disparition. (Cette proposition fit obtenir à Bonaparte l’assentiment de la classe ouvrière).
Le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte.
Dans la nuit du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte qui n’est pas parvenu à étendre ses pouvoirs pour une révision de la Constitution réussit son coup d’État. L’armée occupe Paris, de nombreux députés sont arrêtés, l’Assemblée est dissoute. Dans tout le pays, la contestation est vive. A Paris, 30 000 soldats sont mobilisés pour la réprimer : 380 morts et un nombre important de manifestants sont arrêtés. 10 000 sont déportés en Algérie ou en Guyane ou simplement proscrits du territoire, comme Victor Hugo, Victor Schoelcher. En province, l’armée étouffe rapidement les tentatives et résistances.
A Angers, l’éditorial du Précurseur de l’Ouest publie un article signé par tous les rédacteurs républicains du journal : « Un odieux et criminel attentat a été dirigé contre la République, l’ordre et la constitution. Celui que six millions de citoyens avait appelé à la première magistrature de la République vient de renverser l’Assemblée Nationale, et de dissoudre le Conseil d’État, de suspendre les journaux et d’arrêter des élus du peuple…«
Le 3 décembre 1851 à Angers, une manifestation hostile au coup d’État, regroupant environ 500 personnes, provoque des incidents devant les grilles fermées de la mairie d’Angers. La troupe intervient et arrête 80 personnes. Le siège du Précurseur de l’Ouest est occupé par la troupe. A remarquer qu’aucun ardoisier n’a participé à cette manifestation. Louis-Napoléon Bonaparte, voulant établir un lien direct avec le peuple et obtenir un rassemblement sur son nom, a recours au plébiscite voté au suffrage universel rétabli en son entier en abrogeant le décret du 31 mai 1850.
Plébiscite national des 20 et 21 décembre 1851.

Intitulé du bulletin de vote : « Le Peuple français veut le maintien de l‘autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851. »
Résultats nationaux : 7 481 231 votants répondent oui : (92,03%), non (7,96 %).
Résultats à Trélazé : 764, oui, Non : 17, nul : 1. Soit : 97,77% en faveur du oui.
Dès le lendemain du plébiscite, une législation répressive est mise en place visant à neutraliser toute menace à l’ordre établi. Le 29 décembre 1851 paraît un décret sur les cabarets qui sont soupçonnés de tenir des réunions d’affiliations aux sociétés secrètes. Dès la publication de ces décrets, les Préfets, la police, les magistrats, vont pratiquer une stricte application de cette législation.
Plébiscite national des 21 et 22 novembre 1852.
Intitulé : « Le Peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive et lui donne le droit de régler l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu’il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. »
Résultats nationaux : 7 84 159 répondent oui (96,86%), 263 145 répondent non (3,13 %).
Trélazé : vote oui à 98,87% des suffrages exprimés. La participation a été plus faible qu’aux élections précédentes.
Le 2 décembre 1852, jour anniversaire d’Austerlitz, Louis-Napoléon Bonaparte devient Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Son despotisme a fait naître une résistance, un contre-pouvoir pro-républicain au travers des sociétés secrètes républicaines.
« La Marianne ».
C’est en 1850 que circulent les premières informations concernant une société secrète du nom de « Marianne » qui se fixe pour objectif de rétablir une République démocratique et sociale.
Le 8 Avril 1953, le Préfet de la Mayenne informe le Préfet de Maine-et-Loire de l’existence de la « Marianne » dans le Cher, la Nièvre, la Sarthe, la Mayenne et l’Indre. Ces sociétés sont en relation avec la société secrète de la « Jeune Montagne » de Paris qui est en rapport avec les socialistes Ledru-Rollin et Mazzini réfugiés à Londres. Ceux-ci ont fondé un « Comité Central Européen » qui se charge d’envoyer des consignes aux sociétés secrètes en France. Donner une date précise à la création de la « Marianne » en Anjou, ainsi que le nombre d’affiliés, en vertu de son caractère secret, est impossible. D’après un commandant de gendarmerie, elle aurait été introduite en Anjou en 1852 par un nommé Magne, représentant de la jeune Montagne. Le 14 mai 1853, le Commissaire Central de Police d’Angers écrit au Préfet : « Des individus entachés de socialisme répandent des calomnies contre l’Empereur ; quand ils se rencontrent dans les rues ils se reconnaissent à plusieurs signes. Des signes de reconnaissent sont décrits par le Commissaire : « Lorsqu’ils rentrent dans un cabaret ou tout autre lieu public, ils portent une main à leur coiffure et en en même temps, ils appuient l’autre sur leur poitrine ; en se serrant la main, ils appuient trois fois sur le pouce. Quand ils trinquent ensemble, l’index de la main droite est appuyé sur le haut du verre.«
Le recrutement se fait essentiellement sur les lieux de travail et dans les cabarets. Le nouvel adhérent, lors de son affiliation dans la société, jure fidélité à la république démocratique et sociale et d’abandonner père, mère, femme et enfants pour se dévouer à la cause de la société.
Les ardoisières un terreau pour le recrutement.
Engaillardis, les ardoisiers n’hésitent plus à être rétifs et se solidarisent entre ouvriers d’en-haut et ouvriers d’à-bas, contre la progression du capitalisme. Ils se côtoient davantage dans les mêmes lieux de vie sociale et notamment ceux de détente : cabarets, dans les sociétés de jeux de boule de fort. L’une d’entre elles, la « Maraichère » est particulièrement infiltrée par la « Marianne ».
La crise de la cherté du pain.
Le 6 août 1854, le maire de Trélazé déclare en conseil municipal « que les ressources du bureau de charité sont épuisées et que les plus indigents et les plus nécessiteux sont à la veille de manquer de secours qui leur seraient pourtant nécessaires. Il regrette que la Commission des Ardoisières qui avait accordé 1500 F l’année précédente n’a pas continué à nous venir en aide.«
Le 17 août 1855, le Commissaire de police d’Angers écrit au Préfet : « On constate que les ouvriers gémissent de la misère qui les accable avec la cherté croissante des grains. On attribue la cause aux manœuvres coupables de ceux qui se livrent au commerce du blé, et aussi on répète qu’il y a des accapareurs contre lesquels le gouvernement se devrait d’agir, on ne peut dissimuler qu’une inquiétude sourde et profonde fait redouter de pénibles événements. »
Ce mal vivre éclatera avec l’insurrection de la Marianne à Trélazé.

La Marianne appartient à la légende du prolétariat trélazéen. C’est un symbole, une référence, un moment fort du geste ouvrier. Des hommes épris d’idéal, comme Jean-Marie Secrétain, François Attibert, des travailleurs, qui ont payé très cher, certains de leur vie dans les bagnes guyanais, leur attachement à la République, à la démocratie, aux valeurs monde ouvrier. Comment ne pas s’interroger sur ce qui s’est passé les 26 et 27 août 1855.
26 et 27 août 1855, la nuit des « Marianistes« .
- Le dimanche 26 août 1856, les esprits s’échauffent aux festivités de l’Assemblée annuelle de Saint-Barthélemy-d’Anjou, commune limitrophe de Trélazé. Le bruit circule qu’un soulèvement national est projeté la nuit suivante pour le rétablissement d’une République démocratique et sociale et qu’une marche est prévue pour investir la préfecture d’Angers. Jean-Marie Secrétain s’est rendu à Paris et on lui aurait donné des instructions.
- C’est à Trélazé vers 9 heures du soir que démarre le mouvement. Apprenant que l’un des leurs a été arrêté et détenu à la gendarmerie située dans le bourg de Trélazé, une quarantaine de manifestants investissent la gendarmerie apparemment sans trop de résistance de la part des cinq gendarmes qui s’enfuient par le jardin de la caserne. Les insurgés libèrent leur camarade, s’emparent des armes que les gendarmes n’ont pas eu le temps d’emporter et pillent la gendarmerie. Ensuite ils se rendent chez le Maire Laurent David. Comme il est absent, c’est sa femme qui les reçoit et elle leur abandonne deux fusils de chasse.
- A environ 10 heures 30 au bourg de Trélazé, c’est environ 200 insurgés qui se divisent en trois groupes. L’un avec Joseph Pasquier se rend à la carrière de l’Hermitage et accaparent une charrette qu’ils remplissent d’un baril de deux cents kilogrammes de poudre, de plusieurs barres à mines. Ensuite, ils s’arrêtent à la carrière des Fresnais et s’emparent de barres à biseau, d’une poire à poudre, d’une hache. Le deuxième groupe se rend à la carrière de la Porée, sous la direction de François Attibert, et contraignent le Régisseur de la carrière à leur remettre les armes qu’il possède : deux fusils de chasse. Le troisième groupe avec Pasquier se rend à la caserne des pompiers et chez quelques particuliers détenteurs d’armes qu’ils récupèrent.
- A 2heures 30 du matin, regroupés aux Plaines, lieux du rassemblement général, les Trélazéens, renforcés par l’arrivée d’hommes venus de Saint-Barthélemy- d’Anjou, des Ponts-de-Cé, et d’autres venus individuellement des Justices et Saint-Léonard, quartiers est d’Angers. Ils sont environ 6oo hommes, précédés de la charrette pleine des armes, du baril de poudre et de matériel saisi sur les carrières. Les insurgés au chant de la Marseillaise et autres chants révolutionnaires entrent à Angers par le faubourg de Saumur.
- Vers 4 heures, ils arrivent à l’entrée du faubourg Bressigny. Ils sont surpris de ne pas trouver la ville en effervescence et leurs camarades angevins ayant eu pour mission d’investir la Préfecture et l’Hôtel-de-ville. Personne pour les accueillir et le silence règne, on avance un peu… Ils ignorent que leurs camarades, une quarantaine, regroupés à l’avant kiosque du jardin du Mail devant le Champ de Mars ont été dispersés par la police et que sept d’entre eux ont été arrêtés dont Jean-Marie Secrétain. Un gendarme vient à leur rencontre et les interroge sur leur motivation. Ils voulaient que le pain de six livres passe au prix 1 franc 50. Ils allaient se réunir sur le Champ de Mars et attendre la réponse que ferait l’autorité et que de grands malheurs arriveraient si on ne faisait pas droit à leur demande.
L’affrontement se traduit par la déroute des insurgés.
Malgré tout, résolus à avancer, les insurgés n’entendent pas reculer. D’importantes forces de gendarmerie et de soldats du 51ème régiment de ligne attendent dans l’ombre, boulevard de Saumur, le signal pour intervenir. Quand il est donné, les soldats chargent au pas de gymnastique, baïonnette au canon ; les gendarmes chargent par les côtés C’est la débandade, il n’y a pas de combat… Sur le champ, les gendarmes ont procédé à 110 arrestations. Les émeutiers paniqués se dispersent sans aucune résistance. Ils sont poursuivis par les gendarmes qui en arrêtent 23. La charrette avec le baril de poudre est retrouvée place du Ralliement. Aucun coup de feu n’a été tiré. A 7h40, l’insurrection est considérée « comprimée ». Au total le 27 août 1855, le Procureur Impérial de l’arrondissement d’Angers dénombre 138 arrestations sur le champ ; avec celles qui suivirent le lendemain et les jours suivants, on peut en compter au total plus de 250.
Le 14 septembre 1855, le Ministre de l’Intérieur écrit aux procureurs impériaux et Juges de paix du ressort d’Angers : « Cette odieuse attaque prouve à quelle incroyable perversité sont arrivés les incorrigibles ennemis de la civilisation qui rêvent l’organisation du meurtre et du vol. Ne vous méprenez pas sur le mouvement, ni la politique, ni la cherté des subsistances n’ont été la cause ou le prétexte. La horde de bandits qui se ruait sur une population paisible pratiquait seulement le socialisme que lui enseignent les sociétés secrètes : elles voulaient incendier et tuer. »

Frapper, sévir, se défendre, ce sont les mots que l’on retrouve sous la plume des tenants de l’autorité.
Le 12 octobre, la Cour d’assise, après un réquisitoire sévère du Procureur impérial, prononce toute une série de lourdes peines. Attibert, Secrétain, Pasquier, Riotteau… sont condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée à l’Ile du Diable au large de la Guyane. En outre, 25 inculpés sont condamnés à la déportation simple à Cayenne. 20 totalisent 205 années de détention, 10 totalisent 62 années de prison. Dans les semaines qui suivent, le Tribunal correctionnel parachève cette œuvre répressive qui se veut exemplaire pour infraction à la loi du 28 janvier 1848 réprimant toute appartenance à une société secrète. Il inflige 136 condamnations à des peines fermes allant de un mois de prison à deux ans de prison. S’ajoutent à ces condamnations la privation des droits civiques.
Conséquences à Trélazé.
Du jour au lendemain, de nombreuses familles des prévenus se sont trouvées sans ressources. Le curé de Trélazé, le 3 octobre 1855, écrit au Préfet qu’il est très préoccupé du sort des familles des prisonniers ayant fait partie de l’insurrection de la « Marianne ». Il lui demande d’intercéder pour obtenir des réductions de peines ou la grâce. L’aide financière de la paroisse n’est plus possible. Le bureau de charité de la commune qui n’a que 3000 F de ressources pour nourrir plus de 1000 pauvres. Il est dans l’impossibilité de les secourir et craint d’en voir mourir de faim. Il renouvelle le 3 novembre sa demande. Le Préfet lui oppose un refus tant que les condamnés ne témoigneront pas d’un repentir sincère. Le seul geste que fait le Préfet est de demander aux régisseurs des carrières de distribuer du pain aux familles des détenus.
Le 29 août, la Commission des Ardoisières vote un crédit annuel de 5000 F pour assurer le traitement annuel d’un Commissaire, d’un agent de police, l’un et l’autre spécialement chargés de la surveillance des ouvriers, mettant à profit le désarroi qui s’abat sur les « perrières ». Au lendemain de l’échec du mouvement, les administrateurs des Ardoisières veillent à la stricte application des clauses des règlements établis et dont l’objet essentiel vise à consolider leur autorité.
Bien des questions se sont posées après cette rébellion des 26 et 27 août 1855. Les insurgés ont-ils été trahis par l’un des leurs ? Comment se fait-il que les autorités connaissaient les préparatifs et le jour du soulèvement insurrectionnel ? Il est certain que les sociétés secrètes faisaient l’objet d’infiltrations. Ou bien, qui sait si ce n’est la police qui leur aurait tendu un traquenard aux responsables de la « Marianne » en faisant circuler de faux ordres pour mieux les prendre au piège. Le 28 août 1848, un compte rendu de Tavernier, journaliste du « Journal du Maine-et-Loire » rapporte que durant l’Assemblée de Saint-Barthélemy, dans les cabarets, le signal du mouvement semble avoir été donné par des étrangers.
Un évènement qui va aggraver la situation de Trélazé.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1856, une brèche s’ouvre dans la levée de la Loire à Varennes-Loire. De graves inondations ravagent alors toute la vallée de l’Authion. Le 6 juin 1856, le bourg de Trélazé est entièrement encerclé par les eaux qui s’engouffrent dans cinq carrières. Napoléon III, toujours soucieux de sa popularité, arrive à Trélazé accompagné du Préfet, du Président de la Cour d’appel et de l’Évêque. Il fait acte d’accorder aux sinistrés 10 000 F et débloquer un crédit pour construire une digue qui porte toujours le nom de « Levée de Napoléon » destinée à protéger les carrières et le bourg de Trélazé des inondations. Il espère ainsi atténuer l’image impopulaire laissée en août 1955. C’est ainsi qu’en 1856, au lendemain des inondations de juin, soit moins d’un an après les événements d’août 1855, une partie de la population ouvrière de Trélazé acclame sa Majesté l’Empereur venue apporter des secours aux familles éprouvées.
Tous les condamnés suite à la révolte de la « Marianne », sont amnistiés en 1859. Ne sont pas revenus au pays : Martineau, Secrétain, Riotteau qui sont morts à Cayenne, respectivement le 1er juin 1856, le 5 août 1856 et le 6 août 1856.
Fin de la première partie. A suivre : Les luttes sociales dans les Ardoisières de 1856 à 1920.
Sources.
François Simon : « La Marianne » Société secrète en Anjou.
Maurice Poperen : Un siècle de Luttes.
Jacques Thomé et une équipe d’enseignants : Trélazé cité des faiseurs d’ardoises.
Archives départementales de Maine-et-Loire.
Gallica. Bibliothèque Nationale de France.
Mouvement révolutionnaire angevin.
Du même auteur , site AMOPA de Maine-et-Loire.
Article de Jean Morlong.
Jean Morlong est président d’honneur de l’AMOPA de Maine-et-Loire et commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques. Proviseur honoraire, il est notamment connu pour ses conférences sur les ardoisières et ses visites du site ardoisier de Trélazé.
Site Internet : https://amopa49.fr/
Contacter : contact@amopa49.fr